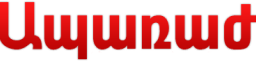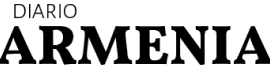Anthony Tchekemian : Le scientifique, l’athlète, l’Arménien de Tahiti
- (0)

par Artsvi Bakhchinyan
EREVAN– FAAʻA, Tahiti, Polynésie française – Anthony Tchekemian, né à Valence, en France, est aujourd’hui Maître de conférences à l’Université de la Polynésie française. Spécialiste en géographie humaine, géopolitique et aménagement du territoire, il enseigne et mène des recherches à Papeʻete depuis 2013.
Sa formation commence par des études professionnelles (BEP, Bac pro., BTSA) en sciences de l’environnement, agriculture, puis des études universitaires en biologie, urbanisme, donnant à ses travaux une portée résolument pluridisciplinaire. Le parcours académique de Tchékémian a débuté par des études en urbanisme à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, suivies d’un doctorat de géographie et d’un poste de Maître de conférences à l’Université de Lorraine.
Sa thèse de doctorat portait sur l’impact de la Politique agricole commune sur les acteurs et les territoires ruraux francçais, une recherche qui lui a valu la Médaille de l’Académie d’Agriculture de France en 2010. En 2023, il s’est encore distingué en obtenant l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) – le dernier diplôme délivré par les universités françaises – avec un projet sur le rôle de l’agriculture urbaine en temps de crise économique, environnementale et sociale.
Aujourd’hui, Anthony Tchekemian continue de publier et de mener des recherches sur le développement des territoires insulaires, en mettant particulièrement l’accent sur la Polynésie française et sa population, où les défis mondiaux tels que le changement climatique et la souveraineté alimentaire rencontrent les traditions locales et la résilience.
Cher Anthony, comment décririez-vous votre parcours académique ?
Mon parcours académique est atypique. J’ai commencé par des études professionnelles en sciences de l’environnement (BEP, Bac Pro, BTSA), avant de m’orienter en Licence de biologie marine, à Marseille. Mon diplôme universitaire m’a ensuite permis d’entrer en licence d’urbanisme, puis master pour me concentrer sur les liens entre “villes et natures” à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, pour m’inscrire ensuite en doctorat de géographie, avec pour directeur de thèse le Professeur Hervé Gumuchian.
Après quatre ans d’enseignement à l’Université de Lorraine, j’ai choisi en 2013 de m’installer en Polynésie française. Là-bas, mon travail de chercheur m’apporte la part d’émotion et d’introspection qui manquait à ma formation. J’ai besoin de me sentir différent, mais sur le fond d’une parenté, d’une proximité. La Polynésie française, par sa culture et ses valeurs, me convient le mieux, car elle résonne avec mes lointaines origines arméniennes.
En 2023, j’ai obtenu le dernier diplôme délivré par les universités françaises, l’Habilitation à Diriger des Recherches.
Je suis aujourd’hui maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches (HDR, obtenue en 2023) à l’Ecole doctorale d’Avignon, avec pour garant le Professeur Philippe Bachimon, que j’avais justement croisé à Grenoble lorsque j’étais en doctorat. Mes travaux à l’Université de la Polynésie française (UPF) s’inscrivent dans une approche pluridisciplinaire et interculturelle, respectueuse de l’histoire de ce territoire et de sa population. Je suis donc rattachés aux unités mixtes de recherche SECOPOL (Tahiti) et associé à Espace-Dev (Avignon).
Je suppose qu’il doit être très intéressant de vivre sur une île tropicale et de les étudier. Dans quoi êtes-vous particulièrement impliqué ?
Mes recherches portent sur les enjeux territoriaux et sanitaires des espaces insulaires tropicaux. J’analyse les tensions entre les modèles agro-industriels et les pratiques traditionnelles, tout en mettant l’accent sur les solutions locales, comme les jardins partagés et les circuits courts. Mes travaux explorent le lien entre souveraineté alimentaire, agriculture vivrière, politiques publiques de santé et dynamiques locales. Ces recherches ont pour objectif de développer une réflexion plus large sur les territoires en transition, face à la mondialisation et au changement climatique.
Je me distingue par une approche inclusive et respectueuse des communautés locales, en m’efforçant de rendre mes recherches accessibles au grand public. Mes travaux en géographie critique et transversale visent à trouver des solutions concrètes et à contribuer à un développement plus durable et plus juste pour les populations insulaires.
Pouvez-vous nous parler de vos ancêtres arméniens ?
Mon histoire commence à Valence (Drôme), en France, une ville avec une forte communauté arménienne. Je suis le fruit de l’histoire d’exil et de résilience de ma famille. Une histoire qui illustre, je crois, le courage de notre peuple.
Ma grand-mère paternelle, Aravnie Garabedian, est née à Beyrouth en 1922, au cours des “marches de la mort” du génocide arménien. Laissée pour morte, elle a miraculeusement survécu grâce à un oncle avant de rejoindre la France. Sans autre statut que celui d’apatride, la famille a trouvé refuge dans la vallée du Rhône, à Valence. Mon grand-père, Bedros Tchekemian, a combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, et a été fait prisonnier pendant sept ans, alors qu’il n’était pas encore naturalisé.
Cette histoire de survie et de lutte est le fondement de mon identité et elle nourrit mon engagement humaniste. Visiter le Centre du Patrimoine Arménien de Valence, le musée des génocides (au pluriel) et y découvrir le nom de notre famille m’a profondément ému.
En parallèle, je pratique le judo depuis l’âge de 7 ans, et j’ai cessé les compétitions l’an dernier à 50 ans, après avoir été sélectionné pour les Jeux du Pacifique… Le code moral de cet art martial m’a permis de faire face à l’adversité, de fonctionner avec des valeurs inhérentes à cette discipline, notamment dans un milieu professionnel universitaire où les coups bas, les jalousies sont légions… A présent, en cessant les compétitions, je gage à devenir plus roseau que chêne, mais si la géographie est un sport de combat (pour paraphraser Pierre Bourdieu, à propos de la sociologie), l’université n’est en rien un dojo.
Tu as dit que la Polynésie te convenait particulièrement parce qu’elle résonnait avec tes lointaines origines arméniennes. Peux-tu préciser un peu plus ?
La Polynésie résonne pour moi comme une terre de mémoire et de résilience, en écho à mes origines arméniennes. J’ai d’ailleurs souhaité m’en expliquer dans l’avant-propos de mon ouvrage L’agriculture tropicale en milieu insulaire entre tradition et innovation, peut-être pour témoigner de mon respect au peuple polynésien. J’ai grandi dans une famille marquée par cette histoire : le génocide, les tortionnaires, les États sourds et aveugles face à l’horreur des marches forcées, des massacres, viols et meurtres les plus sordides et inhumains. J’ai très vite appris ces mots et compris leur sens, alors qu’ils devraient être étrangers aux enfants : exil, souffrance et reconstruction. Les sonorités de la langue arménienne que mon père parlait, celles que j’entendais chez ma grand-mère Aravnie, ses copines, et mes tantes Vartouhie et Alis, me transportaient déjà enfant vers ce territoire caucasien. La Polynésie, terre de migrations, de métissages et de renaissance après des épreuves historiques, me paraît familière : elle dialogue avec l’histoire des Arméniens, peuple contraint de se réinventer en partie en diaspora. En vivant ici, j’ai retrouvé cette force de l’ancrage dans le territoire et de la transmission, essentielle aussi pour ma propre identité.
À part les prénoms arméniens que portent tes enfants, y a-t-il d’autres influences arméniennes dans ta famille ?
Oui, elles sont nombreuses. La langue d’abord : mon père la parlait, et si je ne l’ai pas héritée couramment, j’ai gardé en mémoire des expressions et des sonorités qui forgent une identité. À Gardanne, alors que je suivais un BTSA, j’ai même tenté d’apprendre l’arménien auprès d’une association, mais une année n’a pas suffi pour maîtriser cette langue si belle, riche et complexe. La cuisine ensuite, véritable héritage vivant et gourmand. J’ai grandi avec les odeurs de cuisines, de pasterma, soudjouk, café, olives, dattes, abricots… J’adorais quand la cuisine était investie par les dames lors de la préparation des dolma, beurek, et autres spécialités difficiles à réaliser, mais aussi vite mangées ! Ma grand-mère, excellente cuisinière mais pas pâtissière, préparait des mets dont la saveur reste inégalée, au-delà de tout ce que j’ai pu goûter dans des restaurants orientaux ou même lors de mes voyages en Turquie, notamment à Malatya où ma grand-mère avait vécu. Ma mère aussi avait appris à cuisiner arménien, et nous nous régalions à la maison de ses petits plats. Ma tante Alice perpétue encore ce lien en me régalant de spécialités, et en m’envoyant notamment régulièrement du café à la mouture orientale, que je ne trouve pas ici à Tahiti. Chaque matin, nous partageons en famille un café arménien-tahitien, fait dans un sourjep (ou jazzve) en émail qui appartenait à ma grand-mère : c’est un rituel initiatique pour nous et mes enfants qui me regardent le préparer ! Il faut dire que mon père m’en faisait boire un lorsque, enfant, il me préparait pour partir aux compétitions de judo. Ce rituel simple est une manière de faire vivre la mémoire au quotidien. J’en arrive aux personnalités de mon Panthéon. Il y a eu aussi dans ma famille une figure très importante, aux côtés de ma tante Alice, la sœur de mon père : mon oncle Gilbert. Passionné par l’histoire et la culture arméniennes, il avait accumulé des connaissances impressionnantes sur ce peuple et son destin. Il n’est pas toujours simple, pour les rescapés réfugiés, de se pencher sur cette histoire. Ses lectures, récits, analyses et sa vision m’ont profondément marqué : comme Un poignard dans ce jardin de Vahé Katcha. Il m’avait aussi amené écouter Gérard Chaliand, le poète et géostratège français, près de Charenton-le-Pont, et m’avait offert Mémoire de ma mémoire : un recueil de souvenirs que j’ai dévoré… Quelques années plus tard, j’ai osé demander à Gérard Chaliand de préfacer mon ouvrage Les restes de la Passion, ce qu’il a gentiment accepté de faire, en m’avouant que sa mère se nommait aussi Tchekemian. Mon oncle était, comme on le disait affectueusement, « le plus arménien des Français ». Ses paroles nourrissaient mon imaginaire et renforçaient ce sentiment d’appartenance à une histoire plus vaste que moi. Après, je ne sais la part d’Arménie qu’il y a en moi, mais elle semble dominer : je ne sais pas pourquoi mais, de façon assez innée, j’adore galoper à cheval en m’imaginant être un guerrier des steppes, déguster des grenades, pratiquer le judo sous influence des pays de l’Est (plus orienté vers la lutte), j’aime les parfums de jasmin, de cumin, les musiques et danses orientales…
Je suis fier de ce nom de famille que j’ai transmis à mes deux enfants, nés sur Tahiti, Anouk – Aravnie – Atea (pour le prénom Polynésien, 9 ans) et Axel – Azad – Aroma (4 ans). Mon épouse est originaire de la Lorraine (nord-est de la France). Je revendique mes origines, très certainement car je suis la troisième génération, celle qui a vu ses grands-parents et parents se tuer à la tâche, en acceptant « pour gagner leur vie, le premier emploi qui était vacant [… et qui] pouvait se faire avec un accent », pour citer le Grand Charles. Bien s’intégrer, ne pas se faire remarquer, chercher à tout prix à montrer que nous étions de bons Français… À quoi bon ? J’ai connu le racisme dès l’école primaire, juste en raison d’un nom de famille d’immigrant, très différent de Bouyet Lemaire, Mondet, Palanque, Reboule… Alors j’ai très vite pris le parti des laissés-pour-compte, des étrangers, des personnes souffrant d’handicap, bref des gens différents et souvent rejetés. Mes parents avaient pris soin de me donner un prénom qui estompe le côté étranger justement, pour « faire français » : Anthony. Dommage, j’aurais aimé me prénommer Azad, « Liberté », comme dans Mayrig de Henri Verneuil ! Faut dire qu’elle est précieuse cette liberté, pour un peuple meurtri à la vue de tous, sans que personne n’ait réagit… Donc, je ne me cache plus. Je vis, je travaille, je réussis. Tout ce que je fait, tout ce que j’obtiens c’est pour les miens, pour montrer que l’on peut y arriver, pour les remercier de leurs soutiens, leur bienveillance, qu’ils soient fiers de moi, de nous, d’eux !
As-tu déjà rencontré d’autres personnes d’origine arménienne en Polynésie ? Il y a quelques années, j’étais en contact avec Natacha Mirimanoff, d’origine arméno-tahitienne, et l’année dernière j’ai interviewé Vadim Toumaniants de Papeʻete.
Oui, même si ces rencontres sont rares, elles sont toujours précieuses. Un proverbe ne dit-il pas : « là où il y a deux Arméniens, ils se rencontreront » ? À Papeete, j’ai récemment reçu un très gentil message de Vadim Toumaniantz, qui m’a parlé de ton travail et m’a exprimé sa bienveillance. Ce geste m’a profondément touché. Je n’ai pas encore eu l’occasion de le rencontrer en personne, ni Natacha Mirimanoff, mais je connais leur nom et leur parcours. Leur présence en Polynésie témoigne de l’existence discrète mais bien réelle de la diaspora arménienne dans ces îles. Chaque rencontre, même virtuelle, crée un sentiment immédiat de complicité et de reconnaissance.
Es-tu déjà allé en Arménie ?
Je n’ai pas encore eu l’occasion de m’y rendre, mais c’est un projet essentiel pour moi. Dans l’attente, j’élève mes enfants en leur parlant de la diaspora, des parcours de vie de leurs ancêtres, et en leur transmettant quelques repères sur cette civilisation, cette culture, cet héritage arménien. Je leur raconte que l’Arménie était l’une des plus anciennes civilisations du monde, réputée même en Égypte au temps des pharaons, pour ses musiciens d’exception. C’est aussi la première nation à adopter le christianisme en 301, et ses paysages autour du mont Ararat, désormais en Turquie, sont chargés de symboles. Je leur parle des royaumes d’Urartu et des peuples indo-européens qui ont façonné cette histoire, mais aussi du riche patrimoine de monastères et d’églises, et des épreuves terribles, notamment le génocide de 1915. Je leur montre aussi la complexité du Caucase, une poudrière, ses divisions politiques, ethniques, religieuses, linguistiques, et les conflits du Haut-Karabagh, les rivalités entre puissances, pour qu’ils comprennent que l’histoire arménienne ne peut se lire qu’en relation avec celle de ses voisins et des grands empires. En outre, j’en parlerai tant que la persécution n’intéressera personne… C’est ma façon de lutter.
Qui se souvient qu’en décembre 2022, dans le Haut-Karabakh, l’armée azerbaïdjanaise avait bloqué le couloir de Latchine, unique axe routier reliant Stepanakert à Erevan, empêchant ainsi le ravitaillement des civils, en plein hiver. D’ailleurs, j’explique en cours de géographie des conflits que si on l’appelle communément Haut-Karabagh, je lui préfère le nom d’Artsakh, car la première expression est construite par les mots : kara, qui correspond à la couleur « noire » en turc, bagh qui signifie « jardin » en perse, auquel les Russes ont ajouté nagorny, « haut », en raison de l’aspect montagneux de ce territoire afin de le distinguer de la plaine qui mène à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Cette expression Haut-Karabagh est donc un condensé de la douleur arménienne, par les trois puissances qui ont occupé, dirigé, parfois persécuté les habitants de cette région, dont le nom d’origine, l’Artsakh, fait référence à l’un des rois d’Arménie. En effet, ce nom provient d’Artaxias Ier, fondateur du royaume d’Arménie au IIe siècle av. J.-C. Puis, de nos jours, l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, bombarde les civils dans une relative indifférence, notamment au regard du conflit russo-ukrainien de février 2022. Ce voyage en Arménie aurait pour moi une double portée : un retour intime aux sources familiales, et une manière de transmettre à mes enfants un héritage vivant, non réduit au passé mais ancré dans le présent et l’avenir. Dans mon métier d’enseignant, en particulier dans mes cours de géopolitique, je m’efforce aussi de faire connaître ce pays au cœur du Caucase, d’expliquer sa complexité et son importance, et de montrer aux étudiants la richesse mais aussi la fragilité de cette région.
Tu voudrais ajouter quelque chose ?
Oui, plusieurs choses. Je suis très touché par la personnalité et le parcours de Missak Manouchian, et si heureux et fier qu’il soit enfin entré au Panthéon, en tant que résistant d’origine arménienne, en France et pour elle face à la barbarie nazie. Son courage, son engagement et son sacrifice incarnent la dignité d’un peuple en lutte pour sa survie et pour la liberté. Sa mémoire me nourrit, comme elle nourrit tant de descendants de la diaspora : elle rappelle qu’il est possible de rester fidèle à ses valeurs, même dans l’adversité extrême, et sans se courber et pactiser avec le mal. J’ai aussi été bercé par la voix et les paroles de Charles Aznavour, qui a accompagné mon enfance près de Valence. Ses chansons – bien au-delà de La Mama, Ils sont tombés, Autobiographie… – me rappellent cette époque avec une nostalgie profonde. Mon père chantait à tue-tête à la maison : il aurait pu être la doublure de Monsieur Charles ! Je me souviens aussi tout particulièrement d’un cadeau de ma grand-mère, pour me féliciter d’avoir eu mon doctorat : une place dans les premiers rangs du Palais des Congrès pour aller le voir, tandis qu’elle-même était assise plus loin dans la salle. J’ai pleuré du début à la fin du concert, je ne pouvais plus m’arrêter. Ce geste m’a touché, bouleversé. Ici, à Tahiti, j’ai eu la chance inouïe de le voir en concert, et j’ai même récupéré le mouchoir de La Bohème. En fan inconditionnel, mon père en a sept. Cet objet, au-delà de l’anecdote, est devenu pour moi un symbole affectif, reliant l’artiste, ma famille, ma mémoire et mes larmes arméniennes.
Enfin, je voudrais évoquer un autre aspect fondateur de ma vie : ma pratique du judo. J’ai commencé à sept ans, avec un poster de Bernard Tchoullouyan (1953-2019), ce judoka français qui fut champion du monde en 1981. Et je continue à pratiquer aujourd’hui, à cinquante ans. Je suis ceinture noire 2e dan et ai eu la chance d’être sélectionné pour représenter la Polynésie aux Jeux du Pacifique 2023 et 2024 dans la catégorie seniors (-60 kg). J’ai été champion de Polynésie française en 2022 (-60 kg), vice-champion en 2021 (-66 kg), et j’ai deux sélections aux championnats de France entreprise (2009 et 2011) à Paris. Mais au-delà des résultats, le judo a été pour moi bien plus qu’un sport : un équilibre, une hygiène de vie, un espace de dépassement de soi. Le code moral – politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié – est devenu une boussole que j’applique dans ma vie familiale, professionnelle et personnelle. J’ai également eu une longue expérience d’enseignement bénévole, en clubs, en écoles, auprès de publics variés, y compris d’enfants en situation de handicap. Transmettre le judo, ce n’est pas seulement transmettre une technique : c’est partager une philosophie de vie. J’ai aussi pratiqué le rugby durant quatre ans comme talonneur, une année en junior, puis 3 en sénior, pour obtenir un brevet fédéral d’enseignement. Ce sport de combat collectif m’a passionné : « courage et intelligence », disait-on dans la définition dispensée lors du brevet. Venant du judo, à 17 ans, j’ai adoré ce sport collectif de combat, les copains, les amis, les amours, les emmerdes… comme le chantait Charles Aznavour. Aujourd’hui encore, je considère que ces deux sports de combat, l’un individuel, l’autre collectif, m’ont forgé : deux disciplines différentes mais complémentaires, qui m’ont appris à affronter les épreuves, de pas avoir peur des “montagnes” à faire face à l’adversité, à rester fidèle à une éthique, une parole, son honneur, à l’amitié… à vivre avec intensité et à transmettre aux miens le goût de la vie.
Photos par Doris Ramseyer.